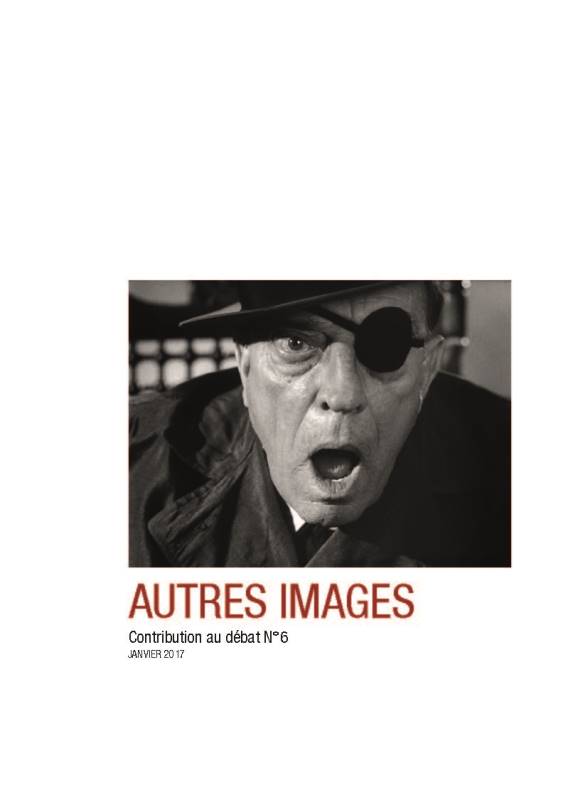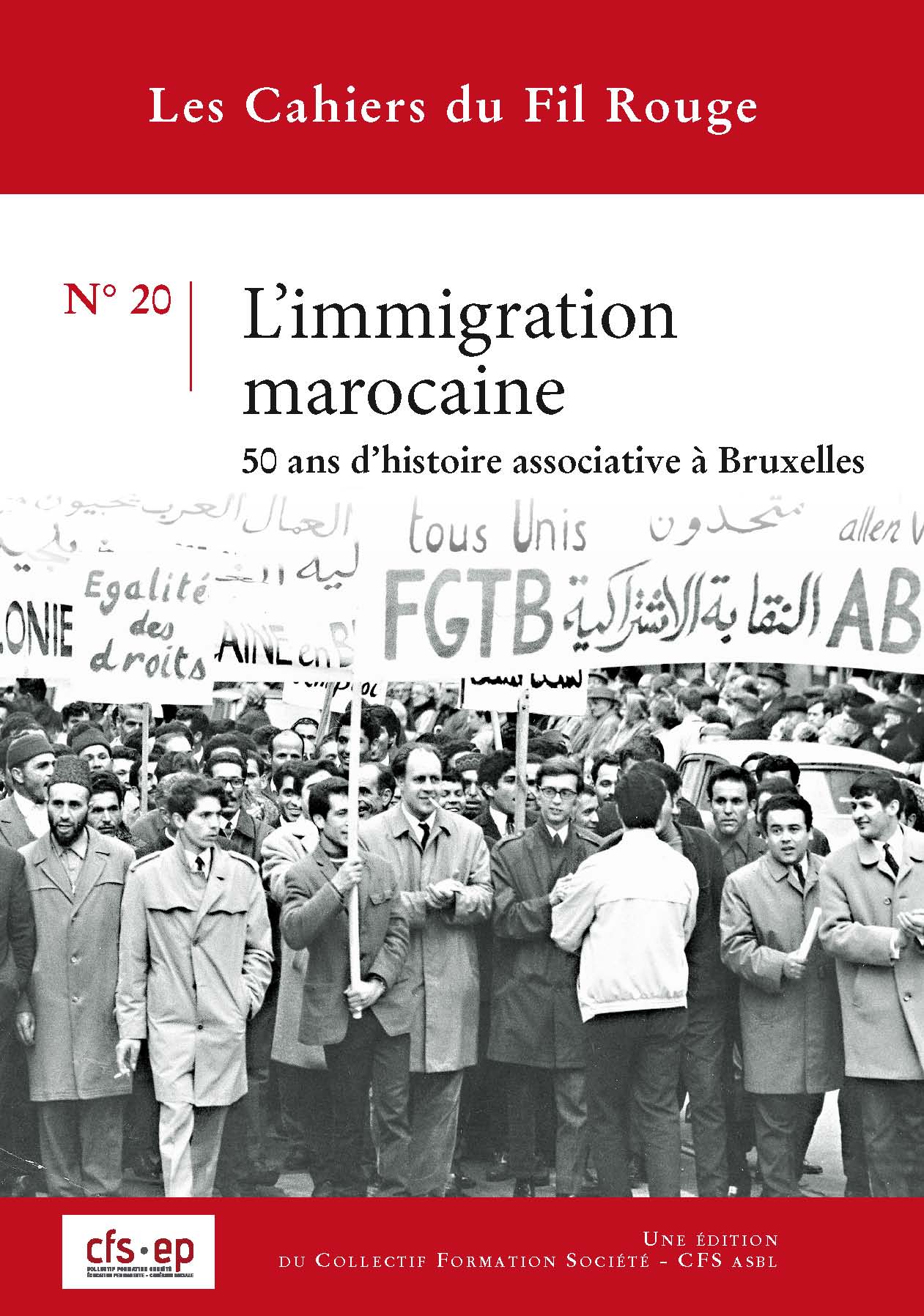Désorganisation et ridicule
Depuis une vingtaine d’années dans le travail social, mais à vrai dire c’est aussi valable dans tous les secteurs de la vie, penser ce que nous faisons se résume très massivement à une méthode : évaluer. C’est-à-dire comprendre ce que ça vaut… rapporter les actions sur une échelle quelconque...
L’action de numériser
Si n’importe quelle évaluation formelle dans le cadre de l’État social actif se veut à la fois objective et prescriptive, la digitalisation est un accroissement exponentiel de ces prétentions.
Art infirmier et numérisation
Les dispositifs numériques se présentent très souvent comme le simple ajout d’un nouveau possible. On implémente ces outils digitaux avec l’argument qu’ils sont simplement une aide, qu’ils n’apportent qu’un plus, qu’ils ne feraient qu’accroître les possibilités d’action des travailleurs sur le terrain. Mais ce qu’ils détruisent et ce qu’ils modifient n’est pas mis sur la balance. Par exemple, quand un dispositif informatique modifie l’admission des patients ou la prise en charge des gardes de nuit, on ne regarde que rarement quel savoir disparaît : qu’est-ce qu’on ne sait plus faire ? Mais aussi, qu’est-ce qu’on invente ? Chaque mode de savoir prend en compte certains éléments, produit ses données d’une manière singulière. Quels éléments sont privilégiés par la numérisation des hôpitaux ? La question ne se résout ni dans une addition porteuse d’espoir, ni non plus dans une soustraction teintée de nostalgie… Plutôt quelque chose de plus complexe à examiner : comment les travailleurs composent avec ces outils ? Mais aussi, quels savoirs ils produisent sur ces outils ?
Au Théâtre ce soir : science et éducation populaire
L’aménagement scientifique d’un quartier à partir d’une modélisation, l’orientation scientifique des élèves à partir de tests psys, la détermination scientifique de l’âge d’un sans-papiers à partir d’un test osseux. Mais aussi d’infinies applications qui modifient le travail, l’étude, les relations humaines, par des traitements informatisés du moindre geste effectué. Des choix de services sociaux organisés à partir de statistiques… Des manières scientifiques de se nourrir et d’évaluer les bénéfices de cette nourriture, de juger la qualité des sols qui la produisent, ou la santé d’une population. Toute une série disparate d’éléments présents dans notre quotidien qui ont en commun d’être regardés, tant bien que mal, comme des services rendus par la science. C’est vague comme ensemble, et bien entendu pas très scientifique. Mais la question est justement cela : la relation avec la science.
Le caractère non-essentiel du travail social
Quelques notes de travail... ce texte n’est pas un « avis » comme un autre, il est produit à partir d’expériences cumulées et de l’étrange expérimentation grandeur nature qu’est le confinement. Il ne s’agit pas d’une analyse « scientifique » de la situation, d’une part parce que ça ne s’est pas passé dans des conditions de laboratoire, d’autre part parce que le savoir qui a été mobilisé dans le travail social est un mélange d’expérience, d’invention, et de quelques éléments théoriques qui a permis de prendre en main beaucoup de situations difficiles sur le terrain. D’où la volonté, non pas de l’opposer au savoir formalisé, mais de l’intégrer dans la production d’un savoir pratique. L’objectif n’est pas de tirer les conclusions ou faire un bilan de ce qui s’est passé, mais d’explorer des pistes de travail, mettre en lumière des questions qui peuvent s’avérer utiles. Regarder surtout comment une action a été possible. Une dernière précision, il ne s’agit pas de chercher des héros à honorer, encore moins de traîtres à dénoncer. Rien d’aussi épique, la préoccupation est beaucoup plus pragmatique : profiter de l’expérience du travail pendant la crise de la Covid. Prendre quelques éléments, qui s’intègrent dans le travail réalisé par la Coordination sociale de Laeken, qui pourraient être intéressants pour la suite...
Virtualisation du travail social
La numérisation des services sociaux, comme du reste, se fait. Tantôt parce que ce serait plus efficace, tantôt parce que c’est moins cher. Ou alors parce que « si on la fait pas aujourd’hui il faudra bien la faire un jour », mais là on ne postpose pas... Bref la virtualisation est une affaire sérieuse, ce n’est pas avec des travailleurs sociaux, des infirmières ou des enseignants qu’elle sera discutée. D’ailleurs, qu’auraient ils à dire ? Il n’iraient pas dire que la numérisation des services sociaux développe un apartheid social, n’est-ce pas ?
Des écueils qui font partie du chemin
Dans une analyse précédente j’ai présenté le sens commun comme la problématique centrale de l’éducation populaire, cette analyse-ci continue en quelque sorte la réflexion qui se poursuivra dans d’autres travaux. Je propose non pas un manuel ni un précis d’éducation populaire suivant ce principe, mais de regarder comment ça pourrait être utilisé, peut-être l’esquisse d’un programme de recherche à venir. Dans ce texte je tenterai d’analyser particulièrement une série « d’écueils » relatifs à la manière d’utiliser les savoirs populaires (la formulation est volontairement très ouverte à ce stade-ci). La liste n’est pas exhaustive, elle est essentiellement issue de mon expérience, d’autres pourront probablement la compléter.
Sortir de la normale
Des textes il y en a beaucoup, de toutes sortes, difficile de voir des traits communs à tout ce qui est écrit, si ce n’est peut-être la longueur. Longueur nécessaire parfois, parce que beaucoup de choses changent, et qu’il devient important de faire un peu le tour, de tout réinterpréter. Mais aussi une longueur qui parfois ressemble un peu à la logorrhée d’une crise de panique, répéter tout ce qu’on entend sans pouvoir s’arrêter ni comprendre ce qui arrive. D’où notre choix ici de tenter quelque chose de plus simple, plus austère, et plus court. D’où cette analyse en trois points qui pourrait nous aider à nous orienter dans ce flot de textes, d’images, d’émotions, de paroles, mais à chacun de faire à sa manière.
Analyse visible également sur le blog : http://sortirdelanormale.hautetfort.com
Éducation populaire et sens commun
Un peu partout il est question du savoir des gens, de ce que l’éducation populaire pourrait en faire. Cette analyse n’a qu’une ambition limitée, poser le problème d’une manière un peu différente,en le reliant au sens commun, cela peut être utile dans la pratique.Dans la situation actuelle, où il est demandé à tout le monde d’obéir aux experts, où le discours officiel est qu’être responsable signifie accepter ne rien savoir d’utile, la question est peut-être encore plus importante, ou du moins plus visible.
Raconter des histoires…
Peut-être qu’il s’agit d’aider les pauvres à être pris au sérieux, en purgeant leurs discours des fictions contre-productives pour leurs intérêts… Mais on peut aussi formuler l’hypothèse contraire : dans un certain mode de pouvoir, les histoires, les fictions, sont une affaire trop sérieuse, il est important de les maîtriser, pour maîtriser les gens. C’est cette hypothèse qu’on tentera de développer ici à partir d’un texte classique : les Contes de Perrault. Dans ce livre emblématique par la portée qu’il a eue et qu’il continue à avoir – car ces histoires, nous les connaissons tous – il est question de s’approprier du commun, en écrivant des histoires qui, jusque-là, étaient racontées oralement. Rien de définitif dans notre travail, le soupçon qu’il y a quelque chose à prendre en compte. Car, si la question n’est pas neuve, elle prend aujourd’hui une importance singulière étant donné le nombre de dispositifs destinés à profiler les clients, les usagers, les citoyens, et l’importance que ces dispositifs ont acquise.