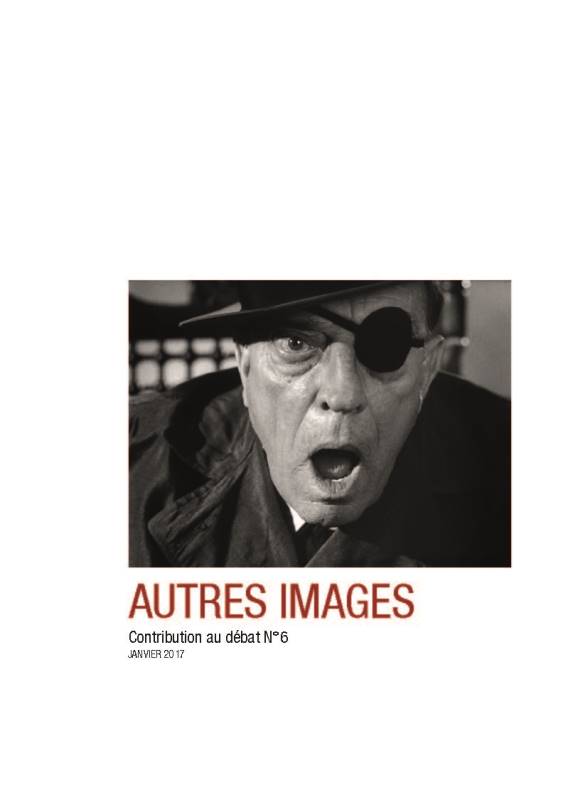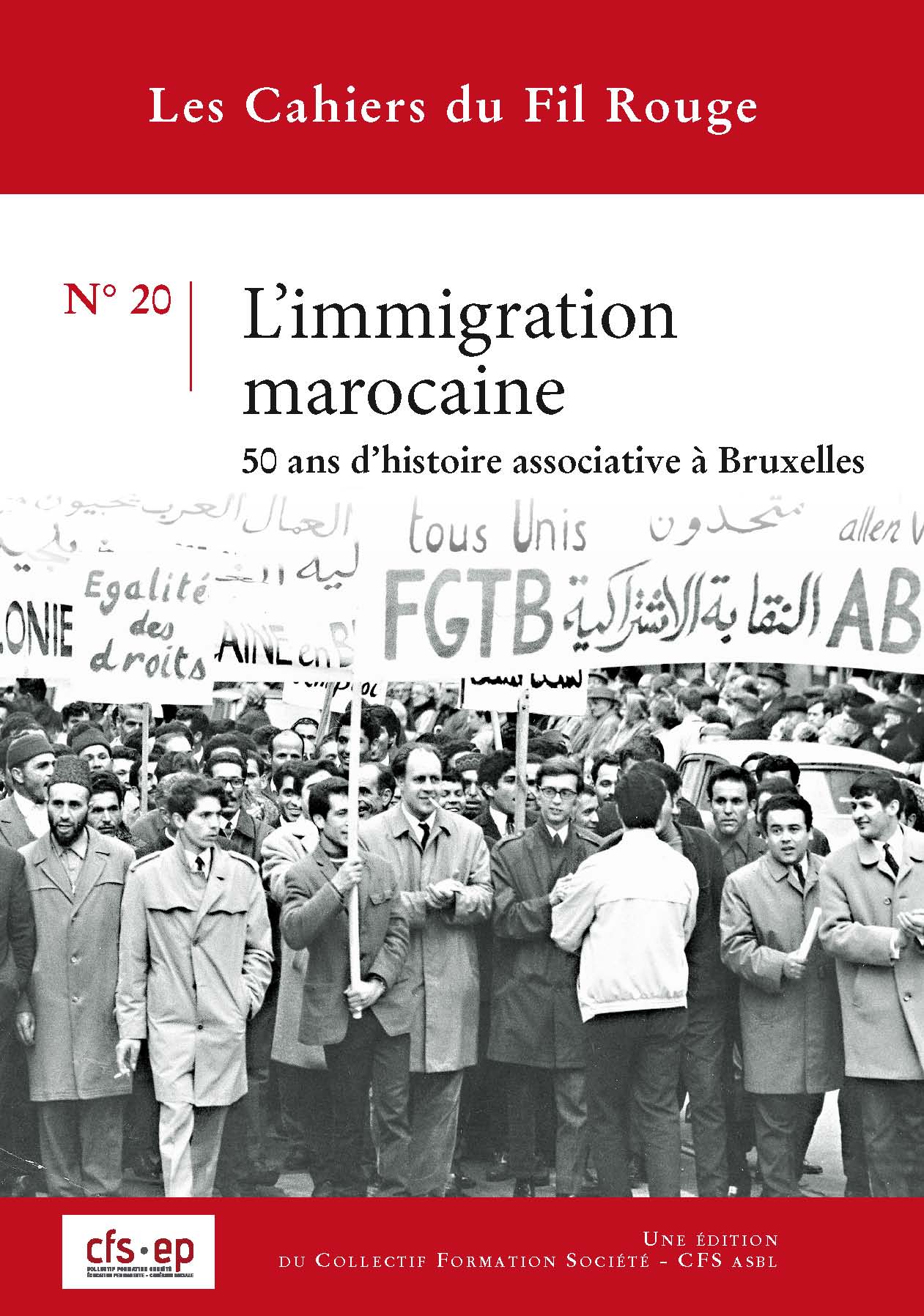Et l’émancipation dans tout ça ?
Moteur de l’éducation populaire, l’émancipation figure parmi ces notions dont la richesse réside notamment dans la plasticité dont peut se prévaloir sa définition. Mais lorsque le sens en devient élastique, c’est sa logique même qui peut s’avérer invertie. Et son acception appelle alors d’autant plus à être questionnée par l’histoire.
La parole populaire par-delà Rancière
À suivre Jacques Rancière et son observation des lignes de partage du monde, là où le peuple resterait habituellement minoré dans le souvenir historique se révélerait un excès de mots rendant son discours inaudible. Un bruit dont il cherchera à libérer la parole populaire en s’acheminant vers l’esquisse d’une histoire hérétique. Cette proposition cependant, les principaux traits ne s’en dessinent qu’en filigrane d’une critique des pratiques historiennes ; elle demeure dès lors difficilement saisissable sans mobiliser une pensée que le philosophe a dépliée au départ de traces du passé gommées par une historiographie soucieuse de dévoiler leur signification véritable. D’une démarche investiguant l’historicité des anonymes à la postérité en tant qu’ils sont les protagonistes de leur temps, comment ne pas retenir davantage que l’intonation de leur voix, sa tessiture ? En quoi l’œuvre ranciérienne plaide-t-elle pour une historisation de leur point de vue et quelles perspectives ouvre-t-elle pour en investir la profondeur ?
Ignorance ou description
L’objectif de ces analyses (celle-ci et d’autres à venir) n’est pas de proposer des fiches de lecture, ni même une bibliographie commentée. On parlera d’une série de livres non pas pour les résumer, les critiquer ou les évaluer, mais simplement pour reprendre deux ou trois problématiques qui nous semblent fécondes pour nos problèmes. Une lecture totalement située et loin de l’exhaustivité.
Dans le texte d’aujourd’hui : « Le champignon de la fin du monde », un livre d’Anna Tsing.
Du côté de chez Zinn. La popularité des luttes
L’histoire populaire telle qu’elle s’écrit désormais ne manque jamais de se réclamer d’Howard Zinn. Et de fait, le zèle avec lequel il s’est employé à rendre au peuple une place centrale dans le déroulé des événements marquants des États-Unis a laissé une empreinte incontournable. Zoom sur les coulisses d’une œuvre devenue paradigmatique.
Art infirmier et numérisation
Les dispositifs numériques se présentent très souvent comme le simple ajout d’un nouveau possible. On implémente ces outils digitaux avec l’argument qu’ils sont simplement une aide, qu’ils n’apportent qu’un plus, qu’ils ne feraient qu’accroître les possibilités d’action des travailleurs sur le terrain. Mais ce qu’ils détruisent et ce qu’ils modifient n’est pas mis sur la balance. Par exemple, quand un dispositif informatique modifie l’admission des patients ou la prise en charge des gardes de nuit, on ne regarde que rarement quel savoir disparaît : qu’est-ce qu’on ne sait plus faire ? Mais aussi, qu’est-ce qu’on invente ? Chaque mode de savoir prend en compte certains éléments, produit ses données d’une manière singulière. Quels éléments sont privilégiés par la numérisation des hôpitaux ? La question ne se résout ni dans une addition porteuse d’espoir, ni non plus dans une soustraction teintée de nostalgie… Plutôt quelque chose de plus complexe à examiner : comment les travailleurs composent avec ces outils ? Mais aussi, quels savoirs ils produisent sur ces outils ?
Au Théâtre ce soir : science et éducation populaire
L’aménagement scientifique d’un quartier à partir d’une modélisation, l’orientation scientifique des élèves à partir de tests psys, la détermination scientifique de l’âge d’un sans-papiers à partir d’un test osseux. Mais aussi d’infinies applications qui modifient le travail, l’étude, les relations humaines, par des traitements informatisés du moindre geste effectué. Des choix de services sociaux organisés à partir de statistiques… Des manières scientifiques de se nourrir et d’évaluer les bénéfices de cette nourriture, de juger la qualité des sols qui la produisent, ou la santé d’une population. Toute une série disparate d’éléments présents dans notre quotidien qui ont en commun d’être regardés, tant bien que mal, comme des services rendus par la science. C’est vague comme ensemble, et bien entendu pas très scientifique. Mais la question est justement cela : la relation avec la science.
Déjà-vu
La pandémie de Covid-19 a d’emblée donné lieu à de nombreuses rumeurs. Quelle qu’en soit la teneur, leur déploiement reproduit un processus en substance fort ancien qui se trouve avoir été sondé en son temps dans sa déclinaison des fausses nouvelles. Toute ressemblance avec des situations ayant existé dans le passé serait-elle vraiment fortuite ?
Sortir de la normale
Des textes il y en a beaucoup, de toutes sortes, difficile de voir des traits communs à tout ce qui est écrit, si ce n’est peut-être la longueur. Longueur nécessaire parfois, parce que beaucoup de choses changent, et qu’il devient important de faire un peu le tour, de tout réinterpréter. Mais aussi une longueur qui parfois ressemble un peu à la logorrhée d’une crise de panique, répéter tout ce qu’on entend sans pouvoir s’arrêter ni comprendre ce qui arrive. D’où notre choix ici de tenter quelque chose de plus simple, plus austère, et plus court. D’où cette analyse en trois points qui pourrait nous aider à nous orienter dans ce flot de textes, d’images, d’émotions, de paroles, mais à chacun de faire à sa manière.
Analyse visible également sur le blog : http://sortirdelanormale.hautetfort.com
Éducation populaire et sens commun
Un peu partout il est question du savoir des gens, de ce que l’éducation populaire pourrait en faire. Cette analyse n’a qu’une ambition limitée, poser le problème d’une manière un peu différente,en le reliant au sens commun, cela peut être utile dans la pratique.Dans la situation actuelle, où il est demandé à tout le monde d’obéir aux experts, où le discours officiel est qu’être responsable signifie accepter ne rien savoir d’utile, la question est peut-être encore plus importante, ou du moins plus visible.
Engagez-vous, qu’il disait !
S’il est d’usage pour un chercheur de situer son analyse par rapport à son implication dans sa recherche, l’affirmation de sa militance ne va pas pour autant de soi. Effet d’une rigueur scientifique, la difficulté à se départir d’une certaine impartialité trouverait-elle quelque issue dans la pratique de l’histoire sauvage ?
- ← page précédente
- page suivante →