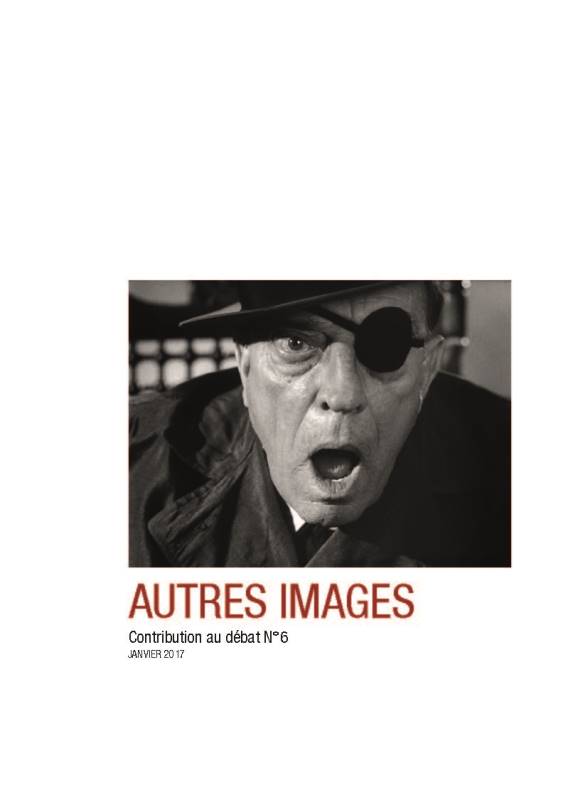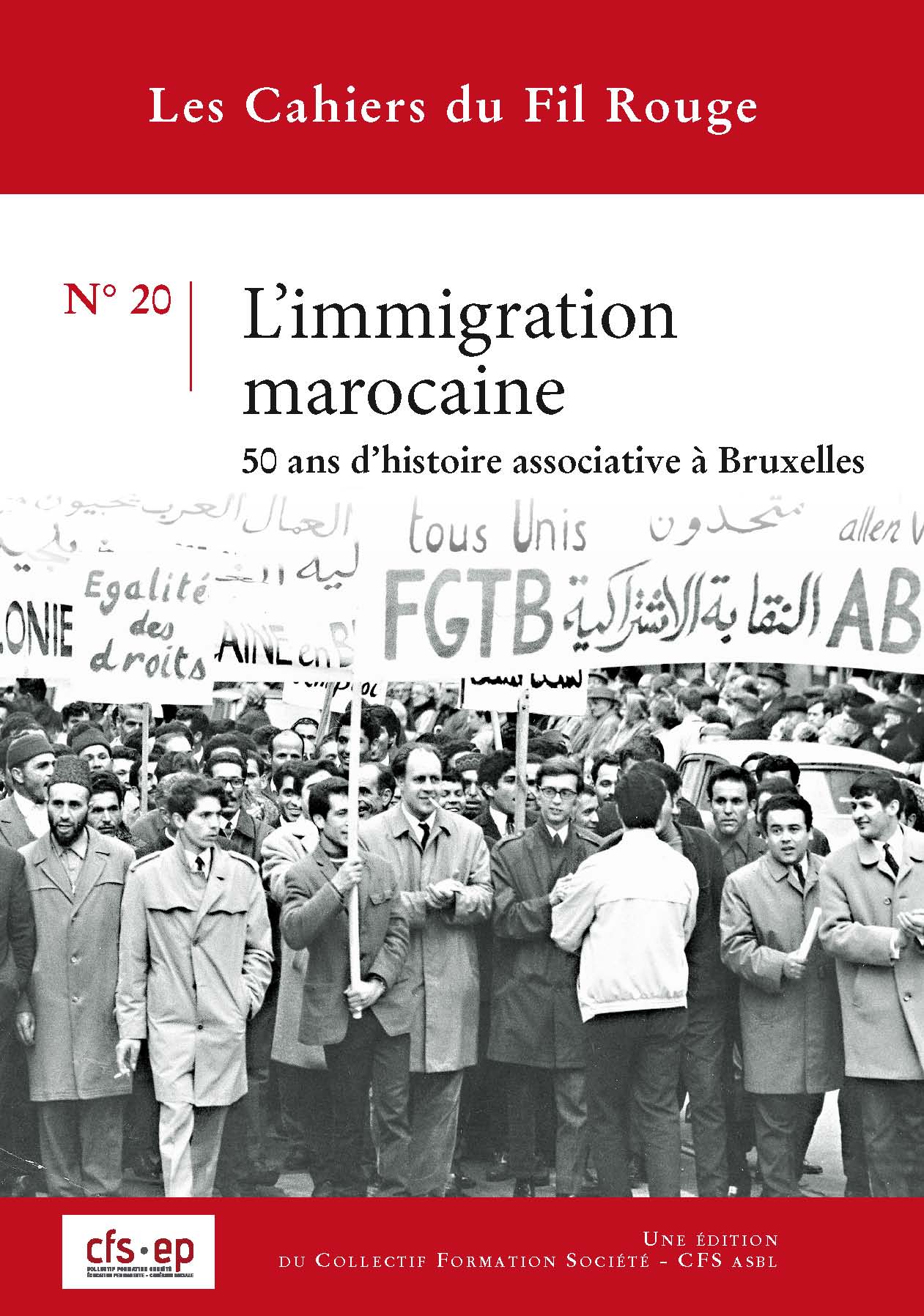Dangereux comme un singe armé d’un couteau
Un homme de la ville de Tlon disait… los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. C’est du moins ce que raconte Borges dans une de ses nouvelles. Le témoignage existait, peut-être, dans un seul des exemplaires du volume d’une traduction espagnole de l’encyclopédie britannique que Bioy Casares détenait dans les années 1940. Cet exemplaire unique comportait quatre pages supplémentaires à propos du monde de Tlon.
Chercher l’humain ?
Il est courant d’entendre demander, exiger, implorer, un peu plus d’humain face à la déferlante de services, applications ou dispositifs numériques. Notamment lorsque nous sommes confrontés à des pannes, des erreurs, des difficultés de différente nature. La dénomination d’autoroute de l’information, un temps très utilisé pour l’internet est assez juste en ce sens. Quand ça avance ça va très vite, mais lorsqu’il y a des difficultés c’est un milieu aride où nous nous trouvons très démunis.
Un peu moins de modestie et de témoignage ?
Dans le texte d’aujourd’hui, un article de la philosophe états-unienne Donna Haraway, intitulé « Le témoin modeste ». « Avec le Témoin Modeste il est en effet question de vérité, de témoignage fiable, de garantie de choses essentielles, de conditions qui permettent de créer la certitude et l’action collective ». Au premier regard le témoin modeste à l’air sympathique et généreux. Dans un monde où de plus en plus il est question de valoriser les avis tranchés à coup de tronçonneuse, il paraît sage de parler modestement de telle manière que ce qui est dit constitue une sorte de socle commun, incontestable. Cette position paraît de moins en moins courante et cette raréfaction est souvent regrettée parmi ceux que la question sociale intéresse. Et pourtant c’est peut-être un peu plus compliqué.
Quelques images des problèmes du solutionnisme
Solutionnisme, le terme est assez imagé, mais peut-être que nous pouvons préciser un peu, disons la manière dont la technique nous apporte des solutions, toujours des solutions et rien que des solutions, y compris à plein de problèmes que nous n’avons pas. C’est un peu sommaire mais il vaut mieux commencer par une description un peu vague qui permet de chercher notre problème plutôt que le cloisonner tout de suite avec une définition trop étroite ; d’ailleurs c’est peut-être cela le problème du solutionnisme. D’où, peut-être, l’utilité de proposer quelques images. Bien entendu, comme disait un cinéaste : non pas des images justes, mais juste des images.
SENS DE L’ORGANISATION OU ORGANISATION DU SENS ?
Comment les archivistes en 2024 tentent de donner un sens à l’information qu’ils et elles reçoivent de toutes parts.
Effets et résultats
Evaluer est une manie de notre temps. Tout évaluer, toujours plutôt deux fois qu’une et si possible, l’idéal serait de le faire en permanence. Regarder les résultats, mettre en mots, prendre conscience, avant même de faire quelque chose, en prévision, puis pendant et aussi après. C’est un peu encombrant mais au moins on est à l’écoute, on sait, on ne se raconte pas d’histoires, on met les résultats au centre, du concret ! Quoique…
Un peu de place pour quelque chose
Depuis juin 2022 la Coordination sociale de Laeken organise des journées « Place à nos droits ». Des journées où des dizaines de travailleurs sociaux descendent dans la rue, concrètement sur la place Boockstael, travaillent ensemble sans rendez-vous et bien entendu en présentiel. Il s’agit à la fois d’un geste pratique : pour toute une série de raisons que nous allons développer dans le corps du texte, cela permet de mieux aider une partie du public. D’un geste revendicatif : s’opposer au tout numérique mais aussi à certaines pratiques présentielles tout aussi inefficaces, voire agressives envers les usagers. Et il s’agit tout autant d’une expérimentation, pour tenter d’amener le travail social vers d’autres logiques que celles de l’État social actif notamment.
Ignorance ou description
L’objectif de ces analyses (celle-ci et d’autres à venir) n’est pas de proposer des fiches de lecture, ni même une bibliographie commentée. On parlera d’une série de livres non pas pour les résumer, les critiquer ou les évaluer, mais simplement pour reprendre deux ou trois problématiques qui nous semblent fécondes pour nos problèmes. Une lecture totalement située et loin de l’exhaustivité.
Dans le texte d’aujourd’hui : « Le champignon de la fin du monde », un livre d’Anna Tsing.
Faire du numérique un problème de terrain
D’une certaine manière un débat sur la numérisation est lancé, en tout cas en ce qui concerne les services publics. Du moins on ne compte plus les réunions dans ce domaine qui jusqu’à peu de temps ne mobilisait pas des ministres ni des directions. Cependant la question s’est posée surtout au niveau des travailleurs de terrain, c’est à ce niveau-là qu’elle a des effets, c’est là que les problèmes sont visibles : au niveau des infirmières, des travailleurs sociaux, du personnel à l’accueil, des bénévoles, de quelques militants... puis elle a fini par « remonter »...
Le temps de la numérisation
La numérisation à l’hôpital est souvent présentée comme une forme de progrès, alliant sécurité, efficacité et rapidité. Mais l’ordinateur peut-il réellement rivaliser avec un·e infirmier·e expérimenté·e ? Est-il possible – et souhaitable – de rationaliser la souffrance d’un malade ? Qui paie le prix de cette informatisation à tout crin ? Pour quel temps (vraiment) gagné ?
- ← page précédente
- page suivante →